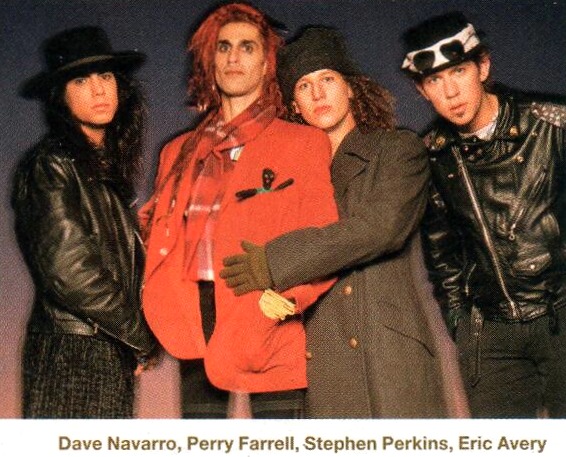Alors là, attention, best seller. Les Ricains en ont
acheté des dizaines de millions de « Bat out of hell ». Il doit être
dans le Top 10 (et vu l’état du « marché » du disque y restera
jusqu’à la fin des temps) des ventes US toutes époques et tous genres
confondus. Le coup d’éclat de deux inconnus, qu’évidemment ils ne
renouvelleront pas, même s’ils s’y sont péniblement essayés.
Meat Loaf, c’est le pseudo d’un gars dont j’ai
oublié le nom, ventripotent gueulard de quinzième zone, coupable d’un disque au
début des seventies que personne a jamais acheté, et second rôle dans le film
culte déjanté « The Rocky horror picture show ». C’est lui le
chanteur et l’attraction de tout ce cirque. Mais de là à ce qu’un inconnu
s’attaque aux records de vente de « Saturday Night Fever » … Le
« cerveau » de l’affaire « Bat out of hell », c’est le
dénommé Jim Steinman, un type qui se prenait modestement pour Berlioz et
Wagner, mais dont la réputation n’avait jamais dépassé sa cage d’escalier.
C’est Steinman qui est responsable, même carrément coupable, du « concept »,
des musiques et des textes. Meat Loaf se contentera de chanter et de
« jouer » un personnage grotesque inspiré par Falstaff, Batman, La
Bête, Rahan et Obélix … La musique, on y reviendra vite fait, est un
croisement-plagiat des pires choses entendues chez les progueux, les
hard-rockeux, Queen (on y reviendra aussi) et … Springsteen.
 |
| Les coupables : Meat Loaf & Jim Steinman |
Dont les deux mercenaires habituels du E Street Band
(Bittan et Weinberg) se retrouvent au casting de ce « Bat out … ». Ce
qui suscite une interrogation, comment ces types réputés ont-ils pu aller
traîner leurs guêtres sur le projet de deux inconnus azimutés ? La réponse
elle est chez les banquiers, ceux qui ont payé ce disque, Epic, filiale de
Columbia, label de … oui, Springsteen, je vois que vous commencez à comprendre.
« Bat out of hell » c’est un peu un coup
de poker insensé financé par la multinationale, sinon, comment voulez-vous vous
payer Bittan, Weinberg, … et les autres. Parce que le casting du disque, ça
file le tournis, Rundgren (pas un tendre quand il s’agit de causer pognon)
produit et joue de la guitare, Edgar Winter (oui, l’albinos à saxo, frère de
l’albinos à guitare), des types d’Utopia (le groupe à Rundgren), pas moins de
deux orchestres symphoniques… Tout ce monde trimbalé dans quantité de studios
plus high-tech les uns que les autres … Du pognon dépensé sans compter mais qui
a rapporté très très gros. Tellement gros, que le Gros et le Steinman se sont
brouillés à mort pour of course des histoires de pourcentages, de droits,
lorsqu’il a fallu passer à un second disque, qui aurait du sortir dans la
foulée (suivant le puissant précepte du on presse le citron tant qu’il sort du
jus) mais qui ne sortira que des lustres plus tard, fatalement dans une
indifférence à peu près générale.
« Bat out of hell », ça fait passer Yes
pour du folk acoustique. Exemple type du morceau crétin « Paradise
… », où l’on passe en dépit de tout bon sens du rock’n’roll, au
rythm’n’blues, à la pop, au disco, au hard, … Comme Queen, me direz vous … en
quelque sorte, sauf que Queen est un groupe totalement second degré, qui dans
sa carrière n’a pas écrit des morceaux, mais juste des pastiches forçant sur la
caricature, le ridicule. Tandis que Steinman, lui, est totalement prétentieux
et dénué d’humour, tout est au navrant premier degré … Heureusement qu’il avait
Bittan et Weinberg, sinon leur patron aurait porté plainte, le premier titre,
l’éponyme « Bat out of hell » est entièrement pompé sur des passages
de « Born to run », et plus particulièrement de « Jungleland ».
Mais jamais Springsteen, pas toujours le type le plus sobre musicalement de la
planète, n’avait sorti de loukoums de ce style.
 |
| Lester, fais gaffe si tu dis encore du mal de mes disques ... |
On n’évite pas non plus l’interminable ballade
(quasi neuf minutes, comme les deux titres cités plus haut) gluante avec les
deux (comme si un seul ne suffisait pas) orchestres symphoniques qui empilent
les couches de violons. Les quatre titres restant sont heureusement plus
courts. Pas forcément meilleurs. L’un d’eux (« You took the words
… ») s’engage même par une discussion genre la Belle et la Bête (la Bête,
vous aviez deviné, c’est Meat Loaf, la Belle c’est Ellen Foley, choriste et
faire-valoir féminine qui délaissera vite le balourd pour fréquenter de près le
Clash, et plus particulièrement Mick Jones), avant un classic rock pompier
comme ça devrait pas être permis … La moins insupportable du lot, c’est pour
moi « Heaven can wait » …
Ce genre d’objet sonore prétentieux, chez moi, ça
finit poubelle direct … mais là, ce « Bat out of hell », il est
tellement con au premier degré que ça me fait pitié … j’en écoute parfois des
morceaux avec le sourire …